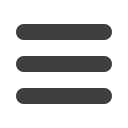

EM
n°58 mai / juin 2017
(15)
omment reprendre une activité sportive lorsqu’on est
terrassé par un cancer ? Le plus dur est de convaincre un
malade de faire le premier pas, disent les soignants, car
une fois qu’il a fait cette démarche, il en éprouve un vrai
mieux-être et l’expérience montre que le taux d’adhésion
est alors très élevé.
En service de cancérologie, le rôle de l’éducateur médico-
sportif est de trouver l’argument qui va faire mouche,
et c’est toujours plus facile à l’hôpital qu’en ville car
la rencontre avec le malade est programmée au même
titre qu’une visite chez le psychologue. Cela se fait
naturellement s’il propose déjà un programme adapté au
sein de l’établissement hospitalier. Des malades, pourtant
prêts à tout abandonner, ont décidé de suivre, en plus de
tous leurs traitements, le programme d’activité proposé.
Non seulement, ils ont déjoué toutes les statistiques quant
à leur durée de survie, mais certains ont même réalisé
de véritables prouesses sportives et sont toujours de ce
monde. Comme ce jeune homme atteint d’un cancer du
poumon, de métastases osseuses, hépatiques et cérébrales
qui, quatre ans après, est toujours vivant et a passé sa
ceinture noire de karaté ! De quoi redonner de l’espoir aux
autres malades, rallumer la flamme.
Les sports proposés dans ces programmes sont variés :
karaté (première discipline pratiquée par les malades),
course, gym, marche nordique, natation, danse
contemporaine, vélo, etc. bien sûr à un rythme progressif
et adapté à la fatigue du malade.
40% à 50%
de rechutes en moins
Les littératures scientifiques internationales le disent et
le répètent : il y a un véritable impact social, clinique et
économique à les mettre en place. Une activité physique
adaptée et régulière permet de limiter les rechutes de 40%
à 50% selon les cancers, d’améliorer la survie de 40%,
et de réduire les effets secondaires liés aux traitements
anticancéreux, notamment la fatigue. L’amélioration de
la masse et de la force musculaires permet de limiter les
douleurs osseuses et musculaires induites par certaines
chimiothérapies. L’efficacité des traitements s’en trouve
améliorée, ainsi que l’observance.
Une étude menée par la CAMI (cf. encadré) et le laboratoire
Amgen, portant sur 1544 patients (une majorité de femmes
dont les deux tiers souffraient d’un cancer du sein),
montre tous les bienfaits du sport dans cette pathologie.
Parmi les bénéfices attendus, les patients interrogés citent
en premier l’amélioration de la qualité de vie et du bien-
être (99 %), des chances supplémentaires de guérir (83 %)
et la réduction de la fatigue et des douleurs.
Autre effet, l’activité physique pendant et après les traitements
du cancer contribue à améliorer l’état psychologique des
patients, en les réconciliant avec ce corps que la maladie a
transformé en ennemi et en renforçant les liens sociaux. En
retrouvant du plaisir en bougeant, l’estime de soi et le sommeil
augmentent, les syndromes anxio-dépressifs diminuent.
Le sport,
sur ordonnance
La loi du 26 janvier 2016 (de modernisation du système
de santé) permet la prescription d’activités physiques et
sportives aux personnes en affections de longue durée,
comme les cancers, depuis le 1
er
mars 2017. Au même
titre qu’un médicament. Un décret du 31 décembre 2016
précise les professionnels de santé chargés de dispenser
ces activités physiques : masseurs-kinésithérapeutes,
ergothérapeutes et psychomotriciens. Exit les associations
qui les proposent depuis des années.
Autre bémol, le décret évite de donner les moyens
financiers pour inclure ces activités physiques et sportives
dans les parcours de soins, laissant aux villes, régions,
agences de santé, réseaux de soins, structures de santé
et associations, la lourde responsabilité des financements,
avec les disparités territoriales que l’on connaît.
Le travail,
une échappatoire
En France, 1 000 personnes apprennent chaque jour
qu’elles ont un cancer et 400 travaillent.
Cette forte proportion d’actifs n’est pas surprenante.
Avec l’évolution des outils de diagnostics, les cancers
sont détectés de plus en plus tôt, ce qui signifie que de
plus en plus de personnes sont confrontées à un cancer
au cours de leur vie professionnelle. De plus, nombreux
sont les malades qui souhaitent conserver leur activité
professionnelle pendant les traitements. C’est le cas pour
presque 50% des femmes actives atteintes de cancer
du sein (étude Calista 2013). Or, dans l’entreprise, le
cancer reste encore trop tabou. Le risque de perdre son
emploi est ressenti par la plupart des malades comme
un facteur aggravant de leur état de santé alors que la
possibilité de poursuivre une activité professionnelle a
souvent un impact positif sur leur qualité de vie.
Rester en poste va aider les malades à se structurer, à
penser à autre chose et à ne pas être totalement dans le
statut de patient qui n’est pas forcément facile à investir.
Concernant les patients pour lesquels l’option de
continuer à travailler est physiquement inenvisageable,
pendant toute cette période et même pendant les
traitements, ils ont intérêt à garder un lien avec leur
entreprise. Il y a un double enjeu social et psychique.
Pour ceux qui se sont arrêtés, la reprise du travail
après la douloureuse parenthèse de la maladie aide à
se reconstruire, à se retrouver une place et être acteur
dans la société. Elle peut aussi traduire la volonté de
combler le vide laissé par l’arrêt brutal des traitements
et rendez-vous médicaux, afin d’échapper à des journées
d’inactivité parfois dénuées de sens.














